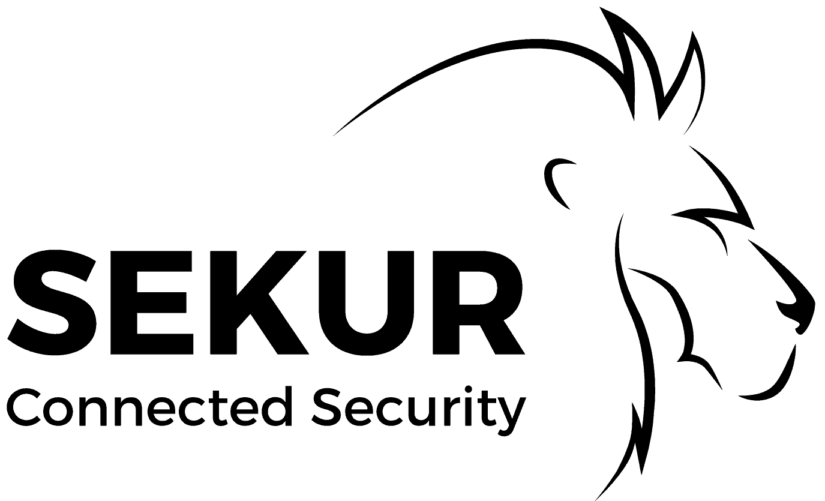C’est dans ce texte que tout devient clair (ou presque). La Convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351) est l’instrument de référence pour toute entreprise de sécurité privée, qu’il s’agisse de surveillance humaine, de gardiennage ou d’intervention mobile. Elle précise de façon détaillée les règles spécifiques applicables aux jours fériés, souvent bien plus protectrices que le Code du travail… mais aussi plus exigeantes pour les employeurs.
Article 9.05 et accord du 2 novembre 1988 : les piliers du dispositif
L’article 9.05 de la convention est sans ambiguïté. Il garantit au salarié le maintien de sa rémunération lorsqu’il ne travaille pas un jour férié, sous réserve de remplir les conditions habituelles d’ancienneté et de présence.
Mais surtout, il pose un principe fort pour les jours fériés travaillés : le versement d’une indemnité égale au salaire brut journalier.
📌 Accord du 2 novembre 1988 – Extrait :
« En cas de travail un jour férié, les salariés percevront, en plus de leur salaire normal, une indemnité égale au montant du salaire qu’ils auraient perçu pour une journée normale de travail. »
Ce dispositif revient donc à une rémunération double, même en dehors du 1er mai. Et contrairement à une prime optionnelle, il s’agit d’un droit conventionnel opposable : aucune entreprise relevant de l’IDCC 1351 ne peut s’y soustraire.
Majoration ou récupération : un choix (mais pas les deux)
Le texte prévoit également que l’entreprise peut substituer cette majoration par un repos compensateur. Autrement dit, si un agent travaille le 14 juillet, son employeur peut décider :
-
soit de lui verser l’indemnité de +100 % (donc une double paie pour la journée),
-
soit de lui accorder un repos équivalent (même nombre d’heures que celles effectuées ce jour-là).
⚠️ Ce choix appartient exclusivement à l’employeur, non au salarié. En revanche, il est impératif de ne pas cumuler les deux : il n’est pas possible (ni légal) de payer double et d’offrir une journée de récupération. Ce serait peut-être généreux… mais ce ne serait pas conforme.
Une convention adaptée aux réalités du terrain
Ce dispositif conventionnel n’est pas le fruit du hasard. Il est pensé pour épouser les contraintes spécifiques du secteur, marqué par :
-
des horaires décalés,
-
un taux d’occupation élevé en soirs, week-ends et jours fériés,
-
la nécessité d’assurer une continuité de service sur des sites sensibles ou stratégiques.
Dans ce contexte, les jours fériés sont rarement synonymes de repos collectif. Bien au contraire, ils exigent une planification rigoureuse, souvent accompagnée d’une gestion fine des effectifs.
Les dirigeants et responsables d’exploitation doivent donc :
-
anticiper les besoins en personnel pour les jours fériés (renforts, remplacements, roulements),
-
gérer les équilibres d’équipe pour éviter que toujours les mêmes agents soient réquisitionnés,
-
documenter et tracer les récupérations ou les paiements de majoration afin d’éviter tout litige ultérieur.